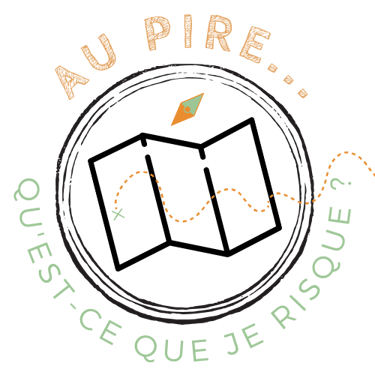Rockabout
Pour mes 27 ans j'ai pas eu de gâteau, mais j'ai pris du désert !
AUSTRALIEAUSTRALIA JOHN2012
« Cette fois mon vieux Milou, on est repartis ! », comme dirait un reporter à houppette. Ça va être mon sac-à-dos, mes panards et moi pour quelques jours à nouveau ! Au moment où j’écris ces lignes, je me trouve en Tasmanie, l’île qui est au sud-est de l’Australie pour les uns, en bas à droite pour les autres. Je suis sur le point d’arpenter pendant une semaine l’Overland Track, connue comme l’une des plus belles pistes de randonnée au monde… Mais comme je ne la commence que demain, je ne vais pas t’en dire plus et je vais plutôt me remémorer avec toi ma dernière marche en solo !
C’était il y a environ pas très longtemps. Enfin si tu me lis en 2095 ça commence à faire, mais quand j’écris, ça va. C’était pendant ma première année en Australie, en 2012 : un patron de ferme pour lequel j’avais bossé quelques mois auparavant m’avait rappelé pour me proposer un job dans une autre de ses exploitations de raisin de table, à quelques dizaines de centaines de milliers de milliards d’années-lumière de la première. On peut dire que ça fait loin, même pour l’Australie, même si tu es en 2095 et que tu vis sur Pluton, même si j’en ai rajouté un peu pour que ça reste impressionnant dans le futur.
Depuis les environs de Brisbane, sur la côte est, il avait fallu rouler trois journées pleines consécutives pour arriver « rapidement » à destination. À peu près vers par là, en plein cœur du pays, où il y a tellement de rien autour sur une carte qu’on peut lire en gros le nom de la petite ville d’Alice Springs. Avec ses vingt mille habitants recensés et ses vingt mille degrés ressentis, elle est la capitale du désert et un point crucial de repos, de préparation ou de ravitaillement pour les voyageurs qui, à part les passagers d’avions, arrivent et partent tous par l’outback, région reculée, hôtesse d’une vie encore sauvage et territoire d’aventures qui ne le sont pas moins.
Ce terme intraduisible littéralement désigne un arrière-pays fantasque, une suprême étendue incolonisable, une inexpugnable immensité dont l’incognoscible nocuité n’aurait d’égale que l’inextinguible majestuosité. Ce désert tout chouchou, donc, laisse à jamais sur les souvenirs et sous les semelles le film fin de sa poussière vermillon. La forte concentration en oxyde de fer donne une teinte rouge à la terre compacte, légère et collante qui plane en volutes colorées et colorantes à chaque passage de véhicule comme autour de chacun des pas qu’on y dépose : les environs d’Alice Springs lui doivent ainsi leur surnom de Red Centre (Centre Rouge).
Là-dessus, entre quelques collines et monts isolés qui pointent comme des mesas et cassent le plat, ici et là, sans prévenir personne, une végétation clairsemée, rase et sèche parsème les vastes plaines. Les aborigènes l’appellent mulga, du nom qu’ils donnent à certains acacias autour desquels se développe l’écosystème local. Il n’y pousse que des espèces assez badass pour survivre dans une terre latéritique (donc pauvre en nutriments et en fertilisants si j’ai bien tout compris à la pierrologie), et sous un soleil capricieux (les températures variant entre -5°C et 50°C au cours de l’année). Je dis badass parce qu’en français on le traduirait par « dur à cuire » : ça convient à certains des arbres, comme les chênes du désert ou les eucalyptus gommiers fantômes, qui résistent très bien au feu ; ça ne convient absolument pas au spinifex (une herbe qui s’appelle réellement triodia, mais toutes deux sont de la famille des poaceae, si j’ai bien tout bon en plantonomie), qui s’enflamme parfois simplement au contact du pot d’échappement d’une voiture. Meilleure façon de démarrer un feu de camp… ou un incendie.
C’est dans cet entour que j’ai passé mon 27ème anniversaire, ce qui n’est probablement rien pour toi mais qui représentait plus pour moi qu’un cap numéral comme vingt ou trente ans : c’était la dernière ligne droite pour entrer dans le 27 Club. « Mais alors, qu’est-ce que c’est quoi qu’c’est ça ? », vas-tu peut être me demander. Il s’agit du club des légendes du rock décédées à 27 ans. Brian Jones, Jim Morrisson, Jimi Hendrix et Janis Joplin, pour les originaux, mais on y associe parfois aussi Kurt Cobain, Robert Johnson ou plus récemment Amy Winehouse. Cet anniversaire signifiait qu’il ne me restait plus qu’un an pour devenir une rock star, entraîner mon public dans mon art et mes délires mystiques avant de mourir, préférablement d’une overdose d’une drogue dure, restant encore à choisir car je ne me drogue pas maman, je le jure.
Cette belle idée de rebelles mélomanes un peu rêveurs, ou de rock stars donc, on l’avait développée et chérie pendant des années avec mon coloc, complice et ami-de-toujours-depuis-longtemps. Ce bon vieux Biggs et moi, on avait plusieurs fois imaginé comment passer le jour de cet anniversaire pour le rendre spécial. Les nôtres n’étaient qu’à deux semaines d’intervalle (c’est toujours le cas aujourd’hui, d’ailleurs) et on s’était dit un jour qu’on fêterait ensemble le passage aux 27 ans lors d’un voyage aventuresque comme ceux qu’on avait déjà vécus par le passé. On s’imaginait par exemple aller au Pérou, se taper un trip shamanique (non maman, ça ne compte pas comme de la drogue) en bas du Machu-Picchu, profiter d’une vision transplanique pour écrire des paroles de chansons extralucides qui nous propulseraient sur des tournées mondiales acclamées et réclamées. Des rock stars, donc. Mais voilà : j’étais loin de tout, lui était dans un autre pays, il m’a fallu improviser un plan B. J’ai pris tout ce qu’il y avait de plus Rock’n’Roll autour de moi, j’ai tout mélangé dans un shaker mental, j’ai laissé décanter un jour ou deux et j’ai vu l’idée naître du cocktail de mes envies…
J’ai d’abord entrevu la possibilité de me faire tatouer dans le dos par un collègue avec une aiguille de couture un Johnny Hallyday géant chevauchant une Harley devant une tête de loup flottant au clair de Lune. C’est vrai que c’est rock, mais j’ai préféré attendre encore. J’ai ensuite vu une idée un peu plus propice aux parages et à la conservation de ce qui reste de ma dignité.
J’avais appris que pour une grande partie des tribus aborigènes, qui vivaient autrefois en autarcie en ces terres, le passage à l’âge adulte n’était pas symbolisé par un âge légal mais par un rite, qu’ils appellent le Walkabout, terme qui confine à l’idée d’errance. Il s’agissait pour l’enfant, vers le début de l’adolescence, de quitter seul sa famille et sa tribu, ce qui n’arrivait que rarement dans ces clans, pas tous les samedis soirs comme chez nous. L’enfant partait alors marcher et… c’est tout. Enfin, c’est simple à décrire mais il partait pour une promenade longue de plusieurs mois et devait survivre seul en parvenant à lire et interpréter les images et les messages de la nature environnante pour se nourrir et se repérer. S’il revenait vivant, il revenait adulte !
Je trouvais le principe beau et fort alors j’ai pris ma décision en réponse à la pensée « au pire, qu’est-ce que je risque à part de me paumer comme un guignol, de me faire piquer par une araignée, ou mordre par un serpent, charger par un bœuf, boxer par un kangourou, ou piétiner par un dromadaire en rut ? » et je m’en suis inspiré pour créer ma petite déambulation cérémonieuse à moi, que j’ai choisi de respectueusement baptiser Rockabout. J’ai commencé par m’arranger pour me libérer trois jours car mon anniversaire n’était pas encore devenu férié. Heureusement, ce n’était définitivement pas assez long pour risquer de devenir adulte et il me resterait douze mois pour grandir et devenir rock star.
Le premier jour, j’ai dû commencer à marcher assez tard car j’avais attrapé une grasse matinée. En plus de ça, j’ai du faire demi-tour après la première heure et tout recommencer puisque j’avais oublié ma flasque de whisky, accessoire préférentiel pour percer dans le rock ou au moins pour célébrer mon anniversaire. Le premier soir, je ne m’étais donc pas éloigné beaucoup de la ferme, j’avais simplement visé un plateau qui me faisait de l’œil depuis mon arrivée sur la ferme. Pas très haut mais surgi de nulle part dans la plaine et cerné de parois abruptes et nues, tout ce relief prenait une couleur rouge vif aux lueurs du soleil couchant, faisant de lui un mini-Uluru, un genre de maquette du grand monolithe sacré de la culture aborigène.
C’était décidé, c’était là que j’allais passer ma première nuit hors de la ferme et des baraquements en préfabriqué alloués aux employés de l’exploitation. À la fin de l’ascension je distinguais même encore ces bâtiments pendant que je m’installais et que le soleil, un peu fatigué sans doute, se préparait déjà à se coucher. L’espace d’un instant, je me suis demandé ce que faisaient mes compagnons tout là-bas au moment où, sans qu’ils puissent l’imaginer, je portais mon regard vers eux. Pourraient-ils me voir s’ils levaient la tête ? Je ne serais probablement à leurs yeux qu’une baguette rougeâtre sur une éminence carminée. Puis je me suis rappelé qu’il valait mieux que j’allume un feu tant que la lumière du jour m’y aidait encore. Heureusement d’ailleurs, car j’ai bien failli tout faire cramer en moins d’une seconde. Ça prend vraiment vite, le spinifex.
Une muraille de cailloux dressée rapidement m’a permis de faire obstacle au vent qui se levait et de stabiliser la situation. Apaisé et rassuré, je me suis étendu à même le sol. La nuit, le ciel dans ce désert est magnifique, d’une incroyable beauté qu’aucune photo ne pourrait illustrer. Pas même celles des calendriers de La Poste, il paraît d’ailleurs que c’est pour ça qu’ils se contentent de chatons.
Souvent, le soir, après le boulot, une partie des travailleurs venait se réchauffer au coin du feu, devant les piaules, avec chacun dans les mains une gamelle et une timbale. Et, inlassablement, le ciel nous balançait ses plus belles étoiles par poignées entières, en en laissant filer quelques unes au passage, pour nous ouvrir sa toute nouvelle nuit. Et, inlassables nous aussi, nous continuions soir après soir à réaliser la chance que nous avions de pouvoir contempler ce spectacle que nous faisions nôtre.
Ce soir-là en revanche, pour la première fois, je me suis fait le spectateur privilégié d’une représentation personnelle et, assis là, ébahi et hébété devant mes milliards de bougies minuscules, je lâchai plusieurs longs soupirs d’admiration. Tout doucement, pour ne risquer d’en éteindre aucune.
Mais bon, il y a un temps pour s’extasier de la beauté du monde et un temps pour bouffer, et la flotte à chauffer sur le feu commençait à gentiment me gicler sur les sabots.
Bizarrement, après mon festin frugal l’ambiance alentour m’est apparue différemment. Comme si un changement d’atmosphère s’était opéré pendant que je boulottais mes pâtes à la bolognaise sans bolognaise. Je ne sais plus combien il y avait d’étoiles, elles semblaient toujours aussi nombreuses, pourtant rien au-delà du trou dans le sol dans lequel dansaient encore quelques flammèches faiblardes n’était éclairé. J’ai marché un peu, quelques pas seulement, pour habituer mes yeux à l’obscurité sépulcrale qui régnait au-delà du foyer. Ça m’a seulement permis de constater à quel point ces lugubres ténèbres noir foncé étaient sombres. Il faisait « plus noir que dans le cul d’un taureau par une nuit sans Lune », pour citer l’Étranger dans le film The Big Lebowski.




Sur celle-là on voit bien comme j'y voyais rien.
Et puis le froid. Oooooh, ce froid… J’en tremble encore ! Comme je ne pouvais plus rien voir d’autres que les étoiles, je me suis couché tout près du feu après y avoir replongé quelques bouts de bois. J’aurais voulu me coucher entre deux bûchettes pour me réchauffer mais une petite voix m’a soufflé que ce ne serait pas très malin. L’instinct de survie exacerbé du mésaventurier, probablement. J’avais enfilé sur moi tout ce que j’avais de solutions : deux paires de chaussettes sous mes chaussures, un caleçon long sous mon pantalon (glamour comme un cow-boy) un t-shirt à manches courtes sous mon t-shirt à manches longues, une veste épaisse sous une veste polaire, chacune avec sa capuche, puis je m’étais emmitouflé dans un drap de soie, glissé dans mon duvet que j’avais enveloppé d’une couverture de survie… et mes tétons pointent encore en évoquant ce froid qui m’a ceint.
À ça s’ajoutaient les bruits. Autant je paradais avec mon sac et ma guitare en quittant la ferme, autant là, couché dans cette noirceur insondable, glaciale et lourde de bruissements, de claquements et d’autres sonorités évocatrices de films d’horreur, l’idée du Rockabout m’apparaissait soudain comme un peu douteuse, voire complètement débile. Je me suis dit qu’en restant couché sans bouger je pourrais peut-être dormir un peu sans me faire remarquer par rien du tout, mais la lueur du feu trahissait de toute façon ma présence sur des millions de sombres lieues à la ronde. Et je ne voulais pas m’éloigner de sa chaleur car je pouvais déjà sentir mes orteils congelés se découper selon les pointillés (il s’est avéré que ce n’était qu’une sensation, aucune perte à déplorer, merci de t’inquiéter). J’ai supplié l’Univers pour que le TAC-TAC-TIC-TAC, que j’entendais tourner autour de moi ne soit pas le présage du retour de ce #@%!& de chien zombie mutant démoniaque thaïlandais enragé que j’avais héroïquement maîtrisé au péril de ma vie, comme tu as pu le lire dans l’article Le Diable résident de Koh Tao.
C’est dans cet état déplorable, transi de froid et de peur, que j’ai passé quelques-unes des plus longues heures de ma vie. C’était effrayant, éprouvant, pétrifiant. À chaque minute, je choisissais pourtant de persister.
Si le choix m’était donné, je le referais de la même façon. Parce que rien n’est plus plaisant à recevoir qu’un cadeau qu’on mérite. Ce matin-là, à l’aube de mes 27 ans, quand la nuit a commencé à s’embraser en son orient, quand la nature environnante s’est lentement illuminée, c’était la délivrance des craintes et des souffrances qui s’annonçait. J’ai accompagné la naissance de ce jour comme s’il était mien, comme s’il était le fait de ma volonté, comme si la pureté de mes pensées encourageait le soleil à déverser son nectar ambré sur toute l’étendue de la vaste plaine devant moi et le laissaient s’épancher depuis les autres tertres jusqu’aux plus insignifiants bosquets, à venir même gentiment secouer les bruns de spinifex pour en décrocher les dernières ombres. Enfin, j’ai contemplé le résultat et il était bon. J’avais souhaité toute la nuit durant que la Lumière soit et enfin, la Lumière était : j’étais le dieu de mon monde ! Et encore, je n’avais même pas pris le café.


Ce jour-là j’ai marché tranquillement, à la fois pour m’assurer de ne déranger aucun serpent, à la fois pour profiter intensément de tout ce qui m’entourait. De tout ce qu’il m’était donné d’exclusif à voir, à sentir, à toucher, à écouter. Quand j’en ai senti l’envie, sans vraiment savoir si j’avais parcouru cinq ou trente kilomètres, je me suis arrêté au pied d’un autre de ces reliefs isolés. J’ai posé toutes mes affaires avant d’aller faire le tour de cette nouvelle colline, je suis monté à son sommet et en réalisant que rien, absolument rien, sur toute la distance que mon regard pouvait couvrir au sol, à l’horizon ou dans le ciel, ne trahissait une quelconque influence humaine, j’ai décidé que ce serait là que je passerai le restant de mes jours. Ou le restant de ce jour, pour commencer. Je suis redescendu chercher mon barda avant de remonter prendre un peu de hauteur, tout poser à nouveau et m’installer cette fois. Je me suis dessapé et je me suis assis nu sur la pierre chaude d’un rocher lisse pour jouer de la guitare et chanturler en buvant du Scotch.
J’avais été un dieu le matin, un aventurier sur le chemin, je me sentais un rockeur à ce moment de l'après-midi. Tout ce temps, je m’étais senti à ma place dans mon monde. Pas besoin d’enchaîner les albums ni de remplir un stade, je relevais mon défi, je réalisais mon souhait et j'assouvissais mon envie de folie !
Joyeux anniversaire, moi !
Ce jour a été celui où je suis entré dans le club des 27 ans. Attention, je ne parle plus du 27 Club, celui des rockeurs morts (je ne suis finalement pas devenu une idole et, spoiler alert, je ne suis pas mort en 2012). Je parle juste du club des gens qui ont eu déjà eu 27 ans au moins une fois dans leur vie. Y’a pas de petite victoire, les gens nés un 29 février n’ont pas cette chance, eux.
Satisfait de cette réussite, j’ai pu laisser s’égrener les notes et les heures avec autant de plaisir que de sérénité. Et je ne saurais dire ce qui, de mon emplacement abrité du vent ou de ma consommation (modérée, oui maman) de ce délicieux Glenfiddich Single Malt 12 ans d’âge, m’a le plus aidé, mais cette deuxième nuit aux belles étoiles s’est révélée beaucoup plus douce, aussi bien moralement que météorologiquement. La magie de cette jolie folie m’a permis de randonner le lendemain frais comme un lardon en foire.
Avec la butte de mon premier campement comme unique jalon à l’horizon, j’ai marché lentement tout en suivant parfois les traces de pattes laissées par les habitants des lieux dont certains, comme des varans, des kangourous ou des aigles, m’ont même offert le luxe de leur compagnie et leur tolérance à la mienne. Quand, au bout de ces heures, je repassais le portail de la ferme en le bloquant derrière moi, je me sentais léger et amusé de constater que malgré la distance parcourue, j’étais toujours exactement à ma place. Le soir même, c’est avec le sourire de celui qui vient de vivre une aventure intense que je m’installai à côté du feu entre deux collègues, ma gamelle dans une main et ma timbale dans l’autre, en regardant les étoiles avec l’impression rassurante que cette nuit encore ça allait être sur moi qu’elles allaient veiller.
Aujourd’hui, alors que je m’apprête à partir une semaine en trek au cœur de la Tasmanie, je me tiens à nouveau proche de la chaleur d’un feu. Au centre de la pièce commune du refuge situé au pied du Mont Cradle, que je partirai gravir demain, une gigantesque cheminée et une caisse de bières réchauffent quelques tablées qui trinquent, s'échangent et se mélangent pour mieux fêter Noël. Je me tiens volontairement à l’écart et je noircis mon carnet de route en me remémorant ces pas dans le désert. J’arrive à la fin de ce récit, je suis content de te l’avoir partagé. Je vais sortir un moment je crois, me trouver un recoin à l’abri du froid cinglant du vent de la vallée et espérer, en les regardant filer, que les étoiles me témoigneront à nouveau leur soutien pour les jours à venir.