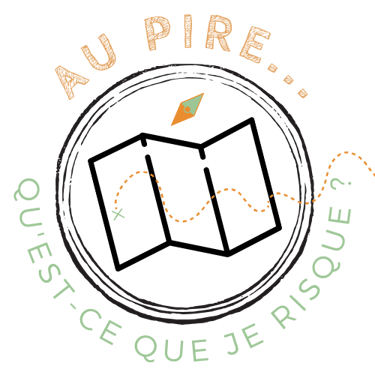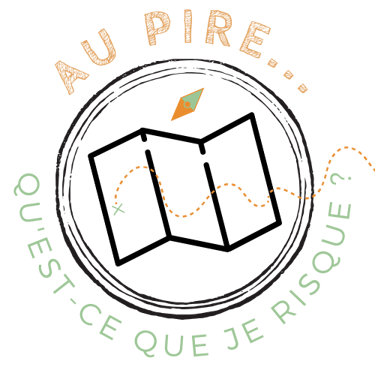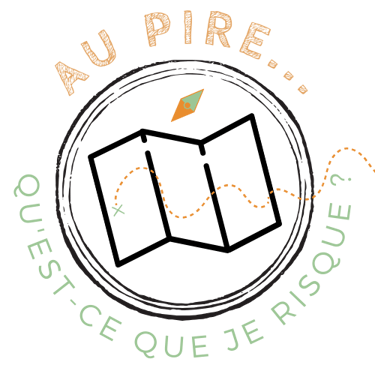Longtemps après, aimer Angkor
Errer dans les ruines des temples d'Angkor est un rêve qui s'est réalisé !
CAMBODGEDÉCOUVERTES2023
Avant d’y aller, je n’avais jamais vraiment rien vu du Cambodge. Ce qui est vrai pour tous les endroits, littéralement, mais je veux plutôt dire par là qu’avant d’y aller, je n’avais pas fait la démarche de me renseigner sur quoi que ce soit du pays. Ce qu’on m’en avait dit avait déjà renforcé une vieille envie d’y faire un tour, notamment en ce qui concerne le fourmillement incessant des résidents résilients, le spectacle glorieux des vieux temples khmers et… la bouffe, sur laquelle je ne vais pas m’attarder pour ne pas manquer la neuvième soupe de la journée.
Car j’y suis, justement, au Cambodge ! Moi qui commençais à t’en parler, ça tombe bien, ça, dis-donc ! Il se trouve que ma couplice Coline et moi nous y sommes rejoints pour vivre quelques aventures au pays du… des… euh… des bonnes soupes, entre autres. Elle, elle connaît un peu de la ville de Siem Reap et de ses alentours, pour s’être rendue plusieurs fois dans ce coin et y avoir déjà lié plusieurs amitiés. En plus de quatre ans ensemble, elle m’en a parlé, évidemment. Plusieurs fois. Et, chaque fois, on a évoqué l’idée d’aller se balader ensemble à Angkor, lieu historique mythique, mystique, magique, magnifique. Tu as sûrement déjà entendu ce nom, ici ou là : le site a été nommé parmi les merveilles du monde moderne et inspire des infinités d’artistes, de voyageurs, d’aventuriers, de penseurs, de contemplateurs et autres esthètes. Il s’étend sur de vastes terres du nord-ouest du Cambodge, en Asie du Sud-est, et on y dénombre quelque chose comme deux cents temples hindous et khmers. Tous multiséculaires, certains même millénaires. Et la plupart sont maintenant accessibles… tout simplement par la route ! Attention cependant, pour d’autres, il faut être à bord d’une voiture tout-terrain qui se fait parachuter depuis un hélicoptère, d’après le film Tomb Raider.
Nous, on n’avait pas spécialement besoin de déjouer une prophétie maléfique de l’espace magique maudit, alors on y est allés à moto : plus simple. Pour s’y rendre, c’est même plutôt bien foutu. Les locaux conduisent comme s’ils n’utilisaient le Code de la Route que pour caler un meuble, mais c’est goudronné, lisse et presque direct depuis la chambre qu’on louait sur place, alors qu’on n’était même pas garés dedans ! Ça mène d’abord droit vers le bâtiment le plus grand et le plus visité, le temple d’Angkor, ou Angkor Wat, dont la région est éponyme. Il a été renommé il y a quelques siècles du nom de l’ancienne capitale de l’empire khmer (Angkor, donc), qui couvrait à son apogée la surface du site actuel et ses alentours. C’était la première fois que je le voyais en vrai et il est imposant, cet étrange palais de pierres et de prières. Bien plus grand que sur le drapeau du pays, comme j’aurais dû m’y attendre. Plus mondu aussi, le jour où on s’en est approchés, alors on a préféré ne pas s’y arrêter et commencer par se rendre un peu plus loin de la foule. On a roulé le long des douves rectilignes de cet édifice un moment, on a pensé le perdre de vue après chacun des virages secs par lesquelles on s’en éloignait, mais c’était sans compter sur ses dimensions épiques. La légende dit d’ailleurs qu’en faire le tour entier prend exactement la même durée que celle de la chanson de Cabrel, tu sais, celle qui fait :
« Et ça continue, Angkor et Angkor,
C’est que le début d’Angkor, d’Angkor ».
En s’écartant par l’ouest pour atteindre un lieu plus calme et pouvoir déambuler dans le silence luxueux des lieux les moins fréquentés par les humains, on s’est approchés d’une autre clairière carrée où trônait un bâtiment moins haut, moins large, mais tout aussi vénérable. Mon introduction physique à la culture khmère s’est faite là, en douceur, en montant les quelques marches pavées extérieures à une enceinte principale. Je parle de construction, pas d’une directrice de lycée qui attendrait un enfant. Cette muraille est, comme c’est généralement le cas, ouverte en son milieu en quatre gopura. Chacun est en fait une entrée, une arche au milieu de chaque façade et qui fait face à une direction cardinale. C’est en marchant lentement sous la Porte Est qu’on est entrés dans la cour du Prasat Bàyon, ou temple de Bayon… Bon, je ne vais pas te mentir, j’étais un peu déçu de n’y trouver ni jambon, ni feria, mais c’était fin joli quand même.
On a arpenté sereinement les passages lithiques de ce temple labyrinthique, au centre duquel nous surplombait toujours au moins une des quatre énormes sculptures de visages érigées, elles aussi, face à une direction cardinale. Comme pour accompagner chaque visiteur où qu’il se rende. Elles sont en fait quatre représentations massives de la compassion éclairée, concept personnifié par le bodhisattva Avalokiteshvara dans l’art bouddhiste. Ou quatre portraits géants d’un joyeux chauve joufflu, si on ne lit pas les panneaux. Tout autour, couloirs, murs, escaliers, dalles, portes, linteaux, absolument tout devait avoir été construit en pierres taillées et en blocs imbriqués tant les robustes bâtiments imposent au regard leur allure préservée des affres du temps. Il n’y manque que des vitres aux fenêtres ! En même temps, si ça aussi c’était en pierre, les types les avaient peut-être déjà virées eux-mêmes. Ce qui expliquerait d’ailleurs les dizaines de cubes massifs entassés dans un coin de la cour : les restes d’un essai de véranda, probablement.


Autour de nous, tout semblait s’être figé dans le temps et le silence. Au-dessus de nos têtes, trois sages oiseaux esseulés planaient sans fuir, portés par un air épais et lourd : dans cette partie du monde, il se peut que ce fussent des grébifoulques d’Asie ou des eurylaimes corydons, même s’il reste probable que des rhipidures à grands sourcils... Ok, bon, j’avoue que je viens de tirer ces informations d’une encyclopédie, je n’ai que de maigres connaissances en oisologie. Les autres habitants visibles ne semblaient être que des lézards (Je dirais un milliard mais j’en ai peut-être compté un deux fois), quelques insectes (la plupart plus audibles que visibles) et deux singes : une maman macaque et son petit macquiot. Macaron. Ou on dit maquereau ? Appelons-le Gilou.
La chaleur des pierres exposées au soleil et la fraîcheur des sous-bois ombragés alentours sont une combinaison gagnante pour eux tous, comme sur la plupart des sites historiques d’Asie du sud-est. Dans ceux que j’ai visités on nous prévient souvent justement que ces petits singes tout mimi-rikiki-choupinets-comme-le-petit-Gilou sont de redoutables voleurs à la tire et que la taille de leurs chicots, même les canines de lait, rend toute négociation déséquilibrée. J’en raconte une, vécue à Bali, dans le chapitre Mon premier contact avec un macaque de mon ebook Au pire, qu’est-ce que j’risque ?. Auto-promo, tu connais. Dans cet épisode, j’espérais ne pas perdre à tout jamais les clés de mon scooter, mais Coline et moi étions cette fois à l’abri de tout incident puisqu’on était à moto et que les motos n’intéressent pas les macaques : leurs pattes sont trop courtes pour passer les vitesses.
Il faisait de plus en plus chaud et nous ressentions tous les deux un soulagement par anticipation à l’idée de monter dessus et de les chevaucher dans le vent. Les motos, pas les singes. Alors quand on les a récupérées, on a décidé de partir par l’arrière du terrain de stationnement et de prendre un rallongi pour se rafraîchir en roulant un peu plus longtemps. Avec le temple de Ta Prohm comme destination, on a suivi un joli petit chemin cahoteux à travers la forêt, assez peu emprunté ou entretenu pour qu’on en vienne à se demander à chaque mètre parcouru si on avait le droit d’être là. Ou si, au contraire, on allait réaliser cette fameuse prophétie maléfique de l’espace magique maudit et saboter le travail de Lara Croft et de son pilote d’hélico-porteur-de-voiture. On a eu un gros, très gros, doute en arrivant devant un portail imposant, à l’allure d’un gopura géant qui n’ouvrirait vers nulle part et dont le sombre nom apparaissait profondément gravé sur une vieille borne penchée : Gate of the Dead. La Porte des Morts…
On n’avait aucune idée de comment montrer nos pass de visiteurs à des morts dont on ne parle même pas la langue, mais très vite une petite troupe de loutres sauvages (bien vivantes) est apparue au pied du mur : elles se sont arrêtées, ont validé notre présence et sont reparties en dodelinant vers les fourrés. En lisant cette dernière phrase tu dois te demander si je ne me suis pas plutôt trouvé possédé par un esprit, ça pourrait sembler plus cohérent, mais non, c’est une vraie histoire avec de vraies loutres dedans. Même que ça vaut le coup que je te la raconte dans un autre chapitre, à l’occasion !
On a bien profité de ce moment unique et insolite avant de reprendre nos errances en roulant un peu n’importe où dans les chemins de traverse jusqu’à ce que ça devienne un peu de la cascade, puis sur des chemins balisés jusqu’à ce qu’on retrouve la route, puis sur la route jusqu’à ce que ça devienne là où on voulait aller. À notre arrivée sur le site de Ta Prohm tombaient des gouttes éparses mais lourdes, annonçant déjà la suite certaine : nous précédions de peu un orage. En juillet, la saison est propice aux moussons, ces brèves tempêtes d’eau qui, quand on se trouve dessous, donnent l’impression de boire plus que de respirer. Pourtant, à la surprise même des locaux, les pluies des journées précédentes avaient été moins denses, moins cinglantes. Moins brèves, aussi : on savait déjà à ce moment qu’il allait falloir attendre longtemps avant que le soleil ne revienne. Mais l’aspect positif était qu’on allait pouvoir se promener entourés d’encore moins de gens ! Alors trempés pour trempés, on y est allés gaiement.
On s’est avancés humidement sur le chemin indiqué, jusqu’à l’enceinte extérieure. De cet endroit, on atteint l’entrée du temple par une allée droite, plate et proprette qui fait partie des quelques éléments qui ont été expertement retapés par des gens visiblement très forts en puzzle. Les pavés avaient d’abord tous été identifiés, ceux éparpillés avaient été réassemblés et les manquants avaient été reconstruits pour donner à cette passerelle un rajeunissement de huit cents ans. Qui lui va à ravir, si je peux me permettre. D’ailleurs, voilà une chouette astuce contre des effets visibles du vieillissement : si un chirurgien esthétique te dit qu’il ne peut rien faire pour toi, va voir un archéologue passionné de Légo, ces gens font des merveilles.
Attention toutefois, sache qu’ils ne s’occupent visiblement pas de l’intérieur ! Une fois dans le temple ça devient flagrant, car la nature a continué son chantier et s’est bien mise à l’aise. Pour exister malgré tout et peut-être même pour son amusement, son plaisir et celui de nos yeux passagers, une partie des murs est devenue végétale. Par endroit, dans des fentes et des interstices nés entre les blocs, se sont conformées des draperies de racines claires sous de larges et vigoureux troncs. Leurs insaisissables branches semblent avoir puisé, dans ce terreau minéral, la force d’étendre leur houppier jusque chez les dieux par ce qu’on nommerait une montée de cime. De l’humus à l’hubris, une écorce compacte, vivante, vivace, presque mouvante et étonnamment coruscante sous ce ciel de fonte, trône, omniprésente désormais, sur ce qui n’est plus pour elle que le vestige d’une vieille fierté de grands chimpanzés imberbes. Et encore, ces arbres sont des Faux Fromagers, imagine si c’étaient des vrais !


Pour ma première visite de ces vestiges évanescents, nous parcourons les passerelles de grès et d’écorce sous une pluie dense, verticale, tiède, et dans un grondement de tonnerre quasiment continu, renforçant encore l’aspect mystique qu’on prête volontiers à tout Angkor. Nous cheminons lentement, nos regards caressent les reliefs sculptés sur les murs, les plinthes, les poutres et jusque sous les toits ; nos doigts ne les auraient qu’un peu plus érodés. Nous n’arrivons à traduire l’humilité que nous ressentons que par notre silence mutuel. Ces lieux n’appartiennent pas, ils tolèrent : l’humain a construit, utilisé, délaissé, retrouvé, modifié… rien ne laisse penser pourtant qu’il a jamais maîtrisé la force qui confond nos sens à cet instant, en cet endroit. En le quittant finalement, une courte éternité plus tard, nous marchons jusque sous les premiers toits de tôles cliquetantes des échoppes montées devant le site, pour nous y faire servir un grand bol de bouillon de légumes. Sa chaleur bienvenue, une fois passée en nous, arrive finalement à nous redonner la parole. Jusqu’à ce que je la reperde en croquant dans un grumeau de méga-piment-nucléaire-force-12 mais je l’ai re-retrouvée après et ça va depuis, merci.
Pendant qu’on vivait tous ces moments, je cherchais déjà comment te les partager au mieux. Je n’ai pas d’appli pour la télépathie (de toute façon même le wi-fi là-bas a dû être conçu en pierre), mais mon cerveau s’est mis à glaner des comparaisons, des phrases, des idées, des mots-clés… et « grandiose » est resté. Je trouve que c’est un bon choix, merci cerveau, pour évoquer ce qu’on ne peut exprimer. Cependant, si on s’autorise à créer un autre terme qui permettrait de masser les notions de dignité ancestrale dans la noble abondance tutélaire et dans sa primauté sur la vastitude, ainsi que d’éternelle sublimité de l’ostensible sagacité architectonique en plus de l’extrême mignonnerie du P’tit Gilou, on pourrait dire que ces lieux sont outreblouffants. J’emprunte ce mot créé par des amis (qui encouragent son usage, vas-y, sers-toi), car il laisse imaginer l’air béat d’admiration que j’ai dû afficher toute cette journée. Et encore, c’était avant qu’on y retourne et qu’on aille déambuler dans l’immense et iconique temple Angkor Wat. On l’a fait quelques jours plus tard et autant te dire que je n’ai pas été déçu, je dirais même que... j’en veux Angkor ! Pardon.
© Le crédit des photos (sauf couverture) de cet article revient à Coline Stagnitto
(www.colinestagnitto.com)